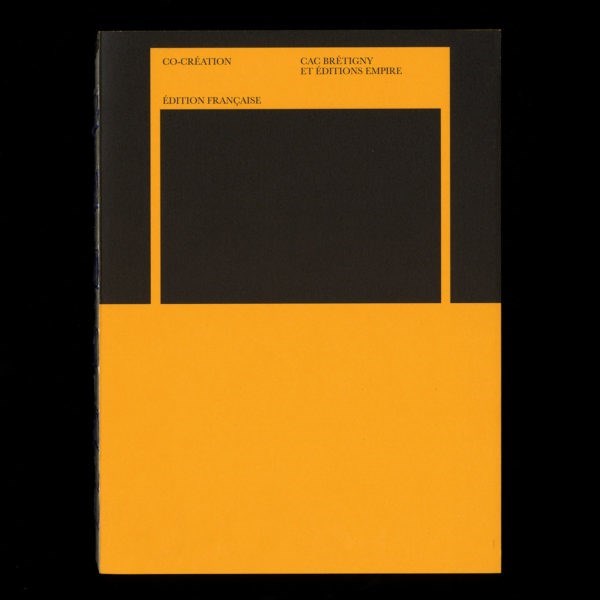Co-Création , dir. Céline Poulin et Marie Preston en collaboration avec Stéphanie Airaud, Editions Empire et CAC Brétigny, 2019.
Avec les textes de Textes de Stéphanie Airaud, Andrea Ancira, Marnie Badham, Virginie Bobin, Caroline Darroux, François Deck, Marie Fraser, Véronique Goudinoux, Núria Güell, Adelita Husni-Bey, Florence Jou, Grant H. Kester, Camille Louis, Pascal Nicolas-Le Strat, Maude Mandart, Christian Maurel, Céline Poulin, Marie Preston, Katia Schneller, Myriam Suchet, Mathilde Villeneuve.
Co-Création est une publication plurielle inscrite dans une recherche sur les pratiques artistiques en co-création engagées dans le champ social, menée depuis 2013 par Céline Poulin (directrice du CAC Brétigny) et Marie Preston (artiste et enseignante-chercheuse à l'université Paris 8) avec la participation de Stéphanie Airaud (responsable des publics et de l'action culturelle au MAC VAL). Elle s'est développée en appui sur trois journées d'études au MAC VAL et au CAC Brétigny, d'un séminaire du master Média Design Art Contemporain de Paris 8 à la Villa Vassilieff et d'une exposition au CAC Brétigny.
Nouvel avancement théorique et non actes de colloque, l'ouvrage
Co-Création permet de rassembler et de faire circuler en France et à l'étranger les apports de ce projet de recherche, sachant qu'aucun livre de référence n'existait en France à ce jour sur ces questions, et que ce livre nous permet de poursuivre un dialogue avec tous ceux qui contribuent internationalement à ces réflexions. Ainsi, ce livre acte le développement d'un travail collectif qui contribue à réunir, entre autres, des universités françaises et internationales, des centres d'art, des musées, une école d'art, etc. Différentes questions posées par les pratiques de co-création et abordées dans les épisodes précédents y sont reprises et approfondies quand de nouvelles ont émergé : quel héritage de l'éducation populaire dans les pratiques de co-création ? Qui parle quand on parle à plusieurs ? Quels sont les enjeux de pouvoirs et de statuts dans un groupe qui œuvre ensemble ? Quelles relations d'intimité, de rapport au quotidien cela implique-t-il ? Quelles interactions existent entre les pédagogies alternatives et les pratiques de co-création ? Quelles méthodologies d'évaluation esthétique ou non sont possibles ?
Constituée de textes théoriques et/ou personnels de philosophes, sociologues, anthropologues, artistes et historien.e.s de l'art et d'entretiens, l'édition s'organise autour de cinq thématiques essentielles et transversales : conversation, collectif, éducation, vulnérabilité et évaluation.
*
Héritages et modalités des pratiques artistiques de co-création
Programme de recherche initié et mis en oeuvre par Céline Poulin et Marie Preston, en collaboration avec Stéphanie Airaud. Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis (AIAC/Teamed). Musée d’art contemporain du MAC VAL à Vitry-sur-Seine. En partenariat avec la Villa Vassilieff et la Kadist Art Foundation.
. Héritages et modalités des pratiques artistiques de co-création // Journée d'étude // 5 décembre 2015 // MAC VAL avec Stéphanie Airaud, Céline Poulin et Marie Preston, Marie Fraser, Adva Zakai & Abake, Christian Maurel, Caroline Darroux
. Programme de conférences // Andrea Ancira, Camille Louis, Éric Baudelaire, Géraldine Gourbe, Marie Fraser, Marinella Senatore, Maude Mandart, Pascal Nicolas Le Strat, Véronique Goudinoux, Zheng Bo.
. L'oralité, le parlé, des pratiques conversationnelles // Journée d'études // 21 janvier 2017 au MAC VAL avec les interventions de Marie Preston, François Deck, Devora Neumark et Sébastien Rémy.
. L'oralité, le parlé, comme modalités de co-création // Journée d'études // 4 février 2017 au CAC Brétigny // Avec les interventions de Marie Preston, Céline Poulin, Simone Frangi & Katia Schneller, Christian Nyampeta et Myriam Suchet.
. Vocales // Une exposition de Céline Poulin, Marie Preston et Stéphanie Airaud / Avec Esther Ferrer, Núria Güell, Adelita Husni-Bey, Leigh Ledare, Devora Neumark, Christian Nyampeta, Marie Preston, Sébastien Rémy, Till Roeskens, Cyril Verde / Du 04.02—23.04.17 / Centre d’art contemporain de Brétigny